

Le dolmen de Gaoutabry
Toponymie
Dolmen
est un mot d’origine celtique. Dol veut
dire table, men, pierre : dolmen=une table de pierre.
«
Gaoutabry » est provençal : la gaouto est la joue ou encore
le versant d’une colline ; l’abri de la colline ronde.
Situation géographique
Situé à 4km
au nord du village de la Londe, il gît
sur un replat naturel sur la crête d’une colline tout près
du Signal du Favanquet (237m), dominant le hameau de Notre-Dame des Maures.
Ce dolmen bénéficie d’une position élevée
et culminante, inhabituelle pour les dolmens provençaux. En effet,
depuis le monument, une vue panoramique s’étend de l’île
du Levant à l’Est jusqu’au Mont Caume à l’Ouest,
ainsi qu’à Notre-Dame des Anges au nord.
Description du monument
Ce monument
s’apparente à un dolmen à couloir, c’est à dire à une
allée prolongée par une chambre. Rappelons que le couloir servait
de liaison entre le monde des morts (chambre funéraire) et le monde
des vivants (l’extérieur).
Pour être précis, ici la chambre est rectangulaire et allongée,
le couloir est court.
Par
cette particularité, ce dolmen fait partie du groupe des mégalithes
du Languedoc dont il est le plus à l’Est. En effet, ses voisins
varois sont à chambre carrée. Cette construction est située à la
charnière de deux zones d’influence.
Construit sur un tertre artificiel ovale de 10m x 6,30m, il est composé d’une
chambre divisée en deux par une dalle transversale et d’un couloir
d’accès. Notons une absence de couverture : soit les constructeurs
s’en sont dispensés, soit celle-ci était en bois, soit
encore les pierres tabulaires se sont cassées et les débris éparpillés.

A l'occasion de l'exposition sur la préhistoire, en mars 2007, notre association a décidé de fabriquer un fac similé du dolmen, afin de le présenter au plus grand nombre.
Après avoir sélectionner des pierres dans les Maures, il a fallu les transporter, puis les mettre en forme, avec l'aide des services techniques municipaux. Ce fut la préparation du clone dont on peut voir quelques images ici.
Les pierres furent ensuites assemblées dans la salle des fêtes. ce montage est illustré par quelques images, ici.
Afin de péréniser ce travail, et de faire connaitre le dolmen, notre association a oeuvré pour que le clone soit implanté au Jardin des Oliviers. Toujours avec l'aide des services techniques municipaux, quelques membres de notre association, ont travaillé à cette implantation dont on peut voir quelques images ici.
Vous ne trouverez plus le clone du dolmen au Jardin des Oliviers. En effet, la nouvelle municipalité ne souhaitant pas que le fac similé du Dolmen soit conservé lors du réaménagement du Jardin des Oliviers, il a été démonté et placé au Centre Technique Municipal en attendant un éventuel remontage clorsque l'espace de loisir de la Brulade verra le jour.
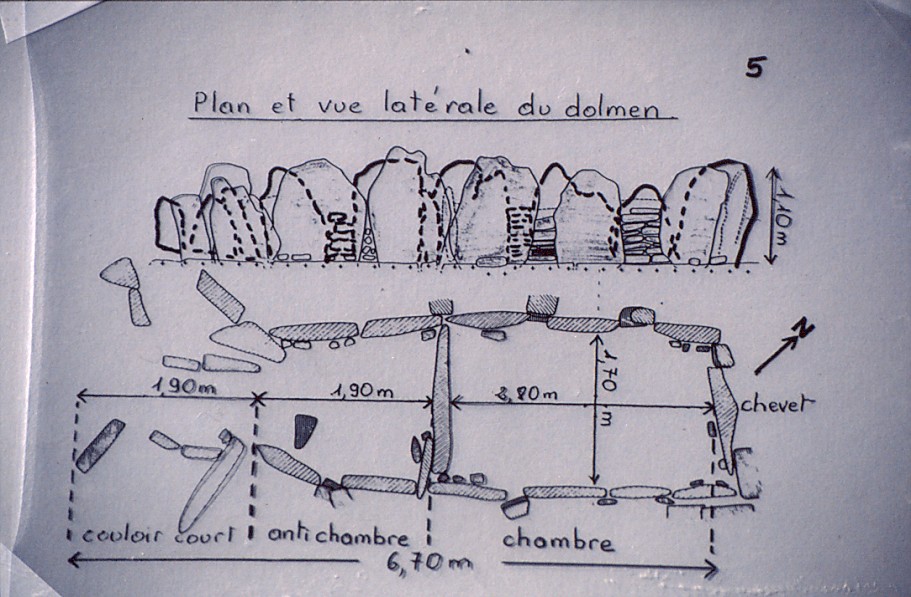
Les minces
dalles en phyllade, c’est à dire
en schistes à grains très fins, ne dépassant pas 1,20
m du sol, ne donnent pas au premier regard une impression de monumentalité.
Il s’agit pourtant du dolmen varois le plus long avec une dimension
de près de 6m. En outre, ces dalles présentent des traces d’aménagement
comme par exemple des bordures arrondies.
Le sol de la chambre a été aplani intentionnellement et le
tertre périphérique à la chambre a été édifié après
la construction de celle-ci, détail inhabituel aussi.
Les matériaux de construction ont été pris à proximité immédiate.
De petites murettes assurent la continuité de l’édifice
entre les dalles.
Orientation
L’orientation
du monument est Nord-Est/Sud-Ouest (225 degrés). C'est une constante
remarquable pour de nombreux dolmens de Provence Languedoc.
Le jour du solstice d’hiver, le soleil se couche dans l’axe
du dolmen.
Le trésor des fouilles
Les premières fouilles connues datent de 1876, exécutées par le baron de Bonstetten. Des travaux furent menés en 1924, 1957 et surtout en 1975 (par M. Sauzade).
Les
restes humains sont réduits à l’état d’esquilles
: les os ont été brûlés avant inhumation. Le
décompte des os temporaux a permis de dénombrer un minimum
de 34 individus présents sur le site malgré les pertes des
fouilles sauvages antérieures.
Il s’agit bien d’une tombe collective.
Datation
Les
objets exhumés lors des fouilles donnent deux périodes d’utilisation
du monument :
- Age du cuivre ancien : - 2800 ans
- Age du cuivre récent : - 2000 ans
Le dolmen de Gaoutabry est «contemporain» des pyramides de Gizèh et des alignements de Carnac.
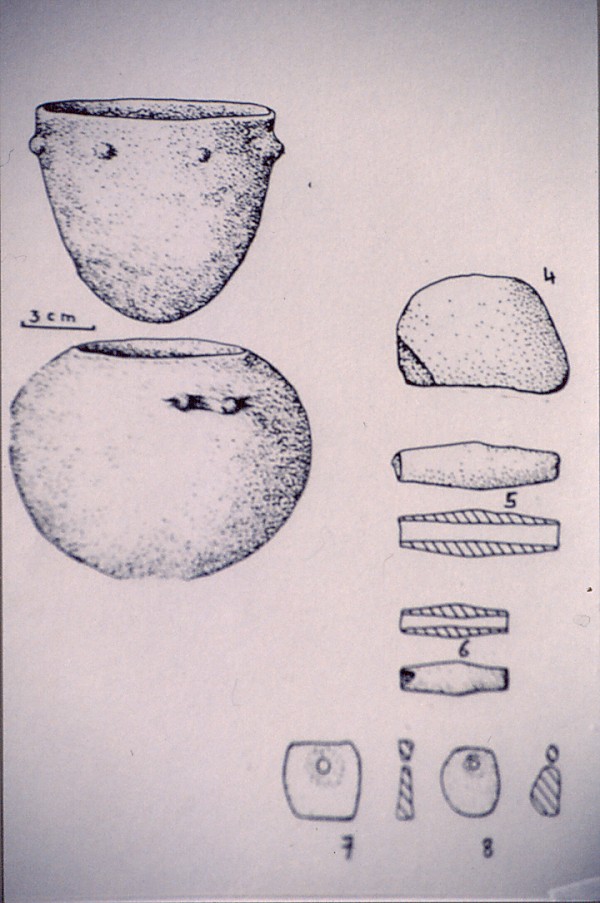
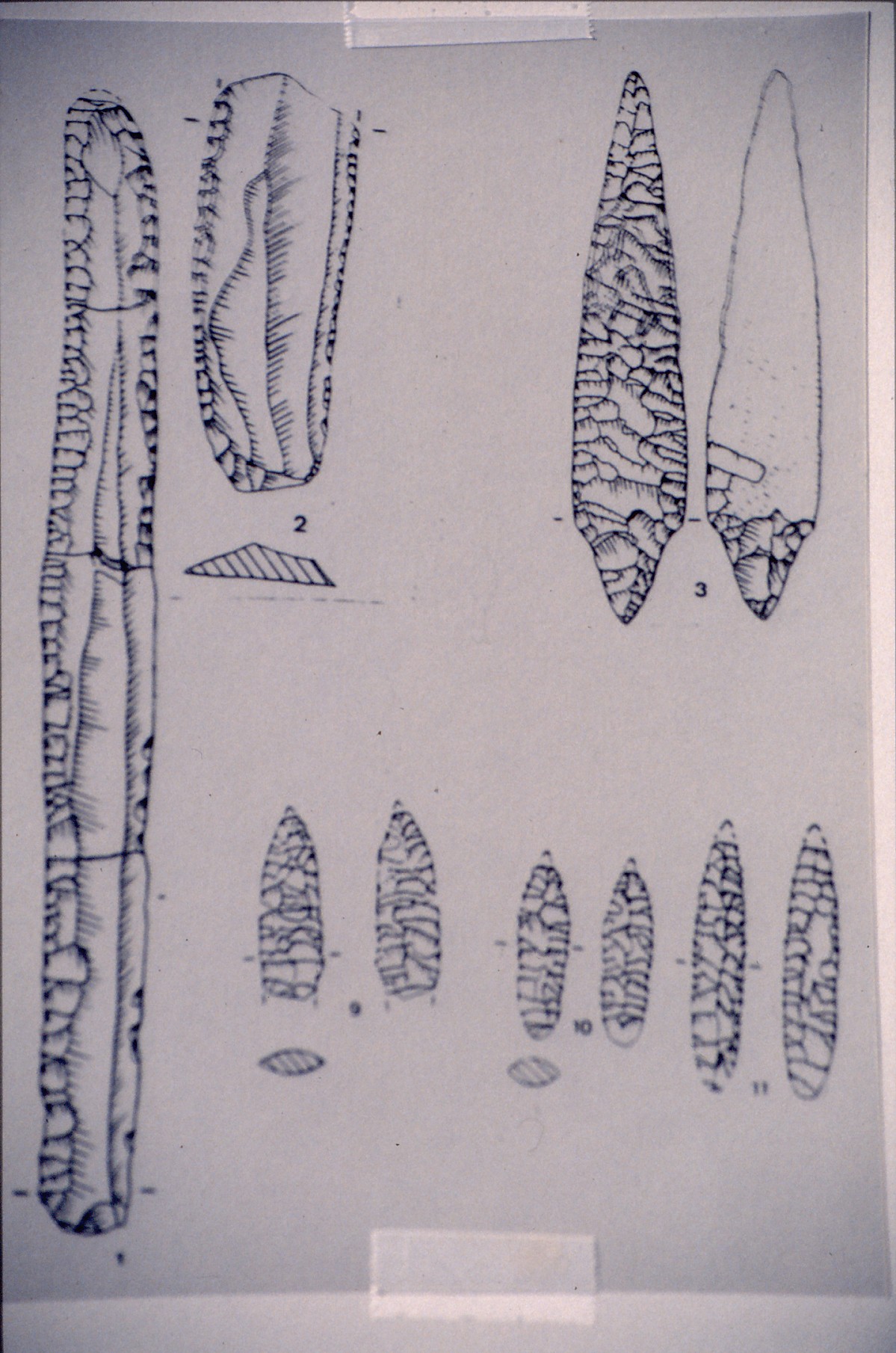
La
céramique comporte des fragments de poterie appartenant à une
dizaine de vases de petite taille. Leur finition est très médiocre.
L’industrie lithique se compose de deux lames (dont l’une de
plus de 30 cm), d’un poignard à soie, d’une vingtaine
d’armatures et de fragments de flèches, d’une hache polie,
d’une parure de 5 perles en serpentine ou en cristal de roche.
L’acidité du sol a pu faire disparaître des éléments en os ou des parures en coquillages.
Conclusion
La
présence
de cette tombe collective sur notre terroir présuppose
une organisation sociale communautaire forte, des croyances très puissantes,
un culte des ancêtres vivace et la proximité d’un habitat
sédentaire : un village de robustes agriculteurs ou éleveurs.
A l’instar des pyramides érigées à la gloire de
pharaon, ce dolmen est le témoignage de la grandeur des idées
de la communauté qui l’érigea.
Sachons à notre tour le valoriser et le conserver pour les générations à venir.